Blog de Xavier Daban, enseignant en Histoire-Géographie Académie de Paris
I - Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945) Thème 1 - La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918)
I - Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945)
LA LONGUE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ (PARTIE DEUX)
CHAPITRE 2 / Du paléolithique au néolithique
Puis à partir de 15 000 ans avant J-C, le climat se réchauffe en Europe.
(Sédentariser : vivre à un seul endroit)
Les modes de vie changent : les hommes pratiquent l’agriculture (l’élevage, la culture des céréales).
Désormais ils ne vivent plus en campements nomades mais dans des villages.
L’agriculture et l’élevage apparaissent d’abord au Moyen-Orient
Ces hommes sédentaires inventent de nouveaux artisanats :
la pierre polie, la poterie, la tapisserie, ils fabriquent les premiers tissus,
la vannerie (fabrication de paniers) est perfectionnée.
On construit les premiers dolmens et menhirs.
B-Premiers États, premières écritures
Ce qui caractérise la ville par rapport au village, c’est la concentration de populations, la taille de l’espace et la présence de monuments (religieux comme les temples, ou politiques comme les palais des rois et des reines). Les temples construits dans la ville d'Uruk en Mésopotamie sont parmi les plus anciens au monde (construction attestée vers 3 500 av. J.-C.). Un état est quant à lui un espace placé sous la direction d'un prince.
Les temples construits dans la ville d'Uruk en Mésopotamie sont parmi les plus anciens (construction attestée vers 3 500 av. J.-C.). La taille des monuments témoigne à la fois d’un usage collectif intense et d’une organisation politique.
Ce que l’on entend par la construction d'états c’est l’émergence d’espace placés sous une autorité politique centrale, souvent monarchique dont le pouvoir est politique et religieux comme les « roi-prêtre » d’Uruk ou les pharaons d’Egypte et d’une organisation juridique et administrative.
Jusqu’à la naissance bien plus tardive de l’écriture démotique en Égypte (650 av. J.-C.) l’écriture est uniquement réservée aux scribes.
L’apparition de la ville, de l’État et de l’écriture demeure mal connue, tributaire qu’elle est de découvertes archéologiques et donc des aléas de la conservation : les premiers hiéroglyphes sont attestés en Égypte à la fin du IVe millénaire avant notre ère, mais on suppose leur invention plus ancienne.
L’Ancien Empire égyptien (IIIe millénaire avant notre ère) est très bien connu grâce à l’abondance des sources et dont nous disposons.
(Déesse de l’Amour et de la fertilité)
(33000 av. J.-C., Uruk)
B. Vestiges du temple « ziggourat » d’Uruk
(fin du IVe siècle av. J.-C.)
C. Un extrait de l’épopée de Gilgamesh
(vers 2500 avant-J.-C.)
D. Tablette d'argile utilisée en Mésopotamie
(vers 3000 av. J.-C.). Le calame, un morceau
de roseau de section triangulaire, sert à imprimer
des caractères dans l'argile encore molle.
Cette écriture des Assyriens et des Sumériens,
en forme de « coins », est appelée cunéiforme.
Les tablettes étaient cuites pour être solidifiées.
E.La momie du pharaon Ramsès II (pharaon de la XIXe dynastie égyptienne ayant régné de 1279 à 1213 avant J.-C., conquérant de la Nubie et de la Palestine et d’une partie de la Syrie, il ordonne la construction du temple d’Abu Simbel)
Byzance et le Monde musulman, suite du Thème I de Cinquième
A - Le fragile Empire byzantin
Résumé à recopier et écrire dans le cahier:
Au IVe siècle, des troubles intérieurs à l'Empire romain ainsi que des invasions barbares provoquent la division de l’Empire romain entre : Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident.
Sous le règne de Théodose l'Empire romain est donc partagé en 2, en 395, avec à l’Ouest, l’Empire romain d’Occident ayant pour capitale Ravenne et, à l’Est, l’Empire romain d’Orient (ou Empire byzantin) avec comme capitale Byzance, placé sur le détroit du Bosphore entre Europe et Asie (anciennement nommée à sa création Constantinople, c'est l'actuelle Istanbul.)
Comme la partie Ouest de l'Empire, la partie Est (orientale) de l'Empire romain traverse une période d'invasions barbares.
Depuis sa capitale, Constantinople, le basileus, l’empereur byzantin, domine un espace impérial étendu et demeure une puissance de premier plan.
Cependant, à partir du VIIe siècle l’Empire byzantin se rétracte, l'Empire perd du terrain.
L’Empire byzantin sous Justinien, au moment de la tentative justinienne de réunification d'un Empire romain unique vers 550.
Par l'Est se profile un nouvelle empire concurrent, l'Empire omeyade, musulman.
En effet, à partir de 634, sous les successeurs de Mahomet, les califes "rachidun" ("les bien guidés") Abu Bakr et Omar ibn al-Khattâb, la Palestine et le Cham (la Syrie) sont conquis. Puis les Byzantins quittent l’Égypte, conquise par les Omeyades de Damas (musulmans sunnites) en 639.
Les territoires espagnols et maghrébins sont perdus peu après au profit des califats musulmans (Omeyades puis Abbassides, leurs successeurs ayant pour capitales Bagdad).
En 1071 ce sont les Turcs seldjoukides qui font irruption dans le Levant après la bataille de Manzikert où ils triomphent des armées byzantines. Cette défaite sans appel marque le déclin profond des byzantin. Ils ont pris Bagdad aux Omeyades en 1058, ils sont les nouveaux maîtres du monde musulmans.
Byzance vers l’an mil
Quels édifices rappellent la ville de Rome?
Christ dit "Pantocrator", mosaïque du 13ème siècle, basilique Sainte-Sophie, Constantinople (photographie prise en 2010)
Présentez ce document.
Que tient le personnage (Jésus-Christ) dans les mains? Pour quelle raison d'après vous? Quel est le message de cette mosaïque?

Pouvoir politique et religion sont liés : le calife est le chef religieux, politique et militaire ; considéré comme un représentant d'Allah, il est le guide de la communauté musulmane, mais dans le sunnisme, il n'y a ni clergé ni hiérarchie religieuse imposée.
I - Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945) Thème 1 - La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918)
I - Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945)
Thème 1 - La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918)

Du au
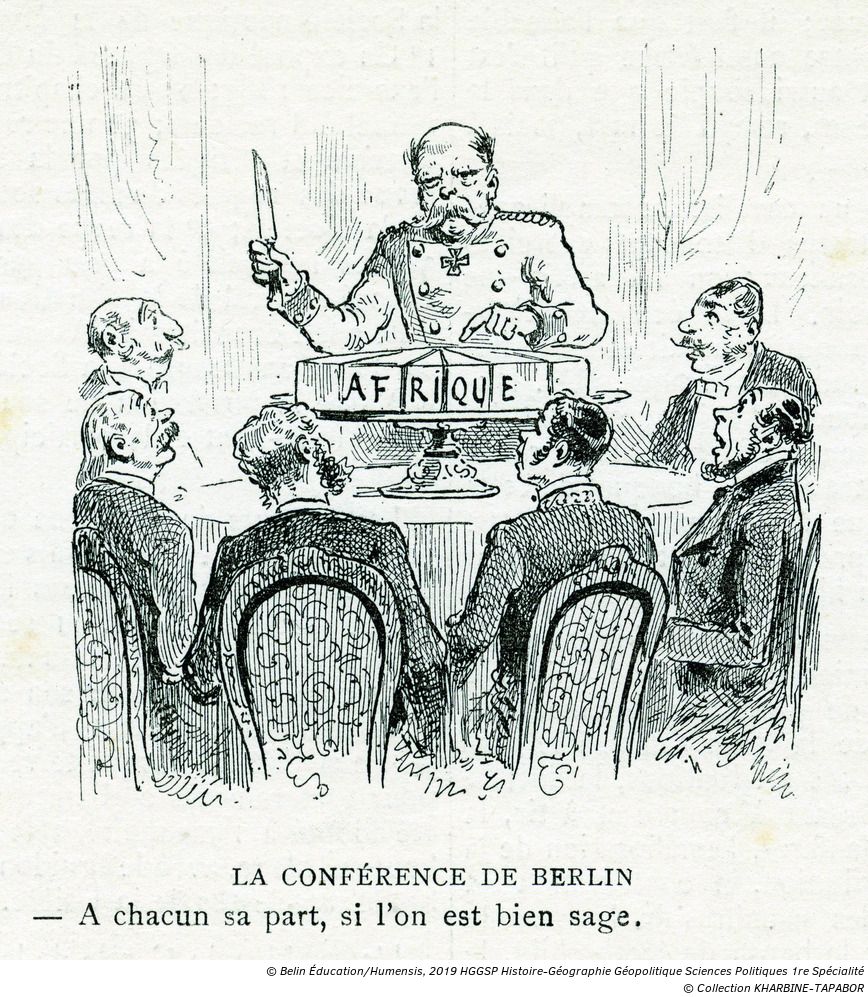
CINQUIÈME Thème 1 - Chrétientés et islam (VIe -XIIIe siècles), des mondes en contact
Thème 1 - Chrétientés et Islam (VIe -XIIIe siècles), des mondes en contact
Problématique : comment des empires étroitement liés à une religion se sont-ils affirmés et confrontés du VIe au XIIIe siècle?
A - Le triomphe du monothéisme
Petit à petit, par leur force de conviction, mais aussi par les persécutions et de véritables expéditions armées, les religions monothéistes nées de la tradition biblique s'imposent en Europe, en Asie mineure, au Moyen-Orient et dans le Nord de l'Afrique.
En Europe, née de l'enseignement oral de Jésus-Christ, codifiée dans les Évangiles, prophète ayant vécu en Palestine au début du premier siècle de notre ère (fils de Dieu pour les chrétiens), jeune juif descendant selon les Évangiles du roi David, c’est la religion chrétienne qui s'impose, mais son culte se divise rapidement entre plusieurs églises d'enseignement.
Deux grands courants chrétiens s'imposent néanmoins :
- La chrétienté apostolique et romaine, de plus en plus hiérarchisée et centrée sur la figure du pape, installée à Rome et utilisant le latin. On parle aussi de chrétienté occidentale.
- La chrétienté byzantine, centrée sur Constantinople, en Orient, dont la langue liturgique est le grec et dont le personnage central est le patriarche de Constantinople.
La séparation des deux églises (ou Grand Schisme) qui dominent la chrétienté est entérinée par deux événements majeurs : la double excommunication du patriarche de Constantinople Michel Cérullaire par le pape Léon IX et du pape Léon IX par le patriarche de Constantinople Michel Cérullaire en 1054 et le sac de Constantinople par les croisés en 1204. Désormais, les deux églises seront séparées.
Les orthodoxes ne tolèrent pas la primauté du pape de Rome et son pouvoir de Justice. Par ailleurs les patriarches orthodoxes prennent leurs décisions de façon collégiale, et non à la manière d'un prince absolu comme les papes romains. Les orthodoxes acceptent l'ordination des prêtres mariés et le port de la barbe et des cheveux longs, peu courantes et peu admises dans le clergé catholique médiéval.
Ainsi Léon IX impose à partir de 1049 des politiques énergiques de lutte contre la simonie, c'est-à-dire le trafic contre argent des biens d'Église, la lutte contre le mariage et le concubinage des prêtres. Grégoire VII continue l'oeuvre de Léon IX en renforçant la formation des curés souvent incultes.
L'élection du pape est réformée. Les papes sont désormais élus par les cardinaux et les laïcs sont exclus de toutes les questions d'investiture.
Sixième Thème 1 - La longue histoire de l'humanité et des migrations (PARTIE 1)
Thème 1 - La longue histoire de l'humanité et des migrations
-
CHAPITRE 2 - L'URBANISATION DU MONDE D - New-York, ville globale. Problématique : Pourquoi la ville de New-York peut-elle être con...
-
CHAPITRE 1 - GRANDS REPÈRES GÉOGRAPHIQUES A. SE REPÉRER SUR LA PLANÈTE La Terre est une planète, une grosse boule aplatie aux pô...
-
CHAPITRE 2 - LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE (1789-1815) Document introductif : une assiette commémorative révolutionnaire. (En regarda...



















